Camille Lankry
Avocate à la Cour | Barreau de Paris
93 rue Monge 75005, Paris
Avocate à la Cour | Barreau de Paris
93 rue Monge 75005, Paris
A. Le parasitisme sur Internet
Le parasitisme est une pratique où une entreprise exploite injustement le succès d’une autre, en tirant profit de sa notoriété et de ses investissements. Dans le contexte numérique, cela se manifeste par la reproduction de fonctionnalités, de caractéristiques visuelles ou de la structure d’un site web.
Il est courant qu’une entreprise accuse un concurrent d’avoir copié son site ou des éléments de celui-ci. La simple inspiration de la valeur économique d’un concurrent peut suffire à établir un acte parasitaire, qui se caractérise par :
· La copie d’une valeur économique spécifique.
· Un avantage concurrentiel provenant d’un savoir-faire et d’investissements.
· L’exploitation d’une notoriété.
Pour établir le parasitisme, il est nécessaire de prouver à la fois l’investissement réalisé par la victime et sa notoriété. Un acte de concurrence est considéré comme fautif s’il va à l’encontre des usages normaux du commerce. Ainsi, dans le cadre des sites Internet, le parasitisme est avéré lorsqu’il y a reprise des fonctionnalités ou de la structure du site.
Ces actes engendrent un trouble commercial, justifiant ainsi une demande d’indemnisation, même si la preuve des investissements réalisés peut renforcer la demande. La victime doit démontrer les pertes potentielles de chiffre d’affaires ainsi que les bénéfices que le concurrent aurait réalisés.
B. Le dénigrement sur Internet
La diffusion rapide d’informations fausses sur Internet constitue un réel danger pour les entreprises. Le dénigrement implique de critiquer ouvertement un concurrent pour détourner sa clientèle, et cela peut se faire via des commentaires négatifs sur divers supports, en particulier sur les réseaux sociaux comme Facebook.
Pour qu’un acte soit qualifié de dénigrement, trois conditions doivent être réunies :
· Les propos doivent être péjoratifs, cherchant à dévaloriser l’entreprise.
· Les propos doivent être publics, comme des commentaires sur des sites d’avis.
· Ils doivent clairement viser une entreprise identifiable.
Par exemple, dans une décision du tribunal judiciaire de Paris du 22 juin 2022, une personne a été condamnée à verser des dommages-intérêts pour avoir publié de faux avis dénigrants, qui avaient gravement nui à la réputation de l’entreprise.
Depuis l’entrée en vigueur d’un décret en octobre 2021, il est devenu plus difficile de demander des données permettant d’identifier les auteurs de contenus dénigrants, sauf dans le cas d’infractions pénales.
C. La contrefaçon sur Internet
La contrefaçon consiste à reproduire sans autorisation une marque ou un droit de propriété intellectuelle d’une entreprise. Internet facilite ces pratiques, permettant un accès facile à des sites internationaux souvent peu réglementés.
Les cas de contrefaçon incluent la copie de conditions générales ou l’imitation de caractéristiques visuelles d’un site concurrent. Des décisions judiciaires ont déjà condamné ces actes, soulignant l’importance de la protection des droits de propriété intellectuelle en ligne.
Pour contrer ces pratiques de concurrence déloyale, plusieurs procédures juridiques peuvent être mises en place. En matière d’Internet, les tribunaux appliquent les règles du droit commun.
A. Action en contrefaçon
Une victime de contrefaçon en France peut saisir le juge français, même si les faits se sont produits sur un site étranger. La Cour de Justice de l’Union européenne a affirmé cette compétence en 2015, soulignant que le lieu de matérialisation du dommage est suffisant pour justifier l’action.
Cette action permet de demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi et d’exiger l’arrêt immédiat des actes frauduleux. Les procédures de référé peuvent aussi être mises en place en cas de manœuvres manifestement illicites, permettant une réponse rapide.
La victime doit prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux, en utilisant des preuves telles que des captures d’écran ou des témoignages.
B. Action pour parasitisme
Dans le cas d’une action pour parasitisme, il suffit de prouver que le site Internet constitue une « valeur économique » protégée. Les fonctionnalités d’un site ne sont pas nécessairement protégées par le droit d’auteur, mais des actes de parasitisme peuvent être poursuivis.
Le tribunal compétent est généralement le tribunal de grande instance, qui peut être saisi en urgence pour faire cesser les actes de parasitisme. La jurisprudence a établi que la présentation et les fonctionnalités d’un site peuvent être protégées sur la base du parasitisme.
C. Action en dénigrement
Il est crucial de rassembler des preuves de dénigrement avant leur suppression, en enregistrant les URL et en faisant des captures d’écran. Une fois les preuves en main, la victime peut demander au responsable de retirer le contenu illicite. Si cette démarche échoue, un recours auprès de l’hébergeur peut être envisagé, car celui-ci pourrait être tenu responsable s’il ne réagit pas face à des contenus nuisibles.
Si aucune solution amiable n’est trouvée, une action en justice peut être lancée pour obtenir des réparations et faire retirer les propos dénigrants.
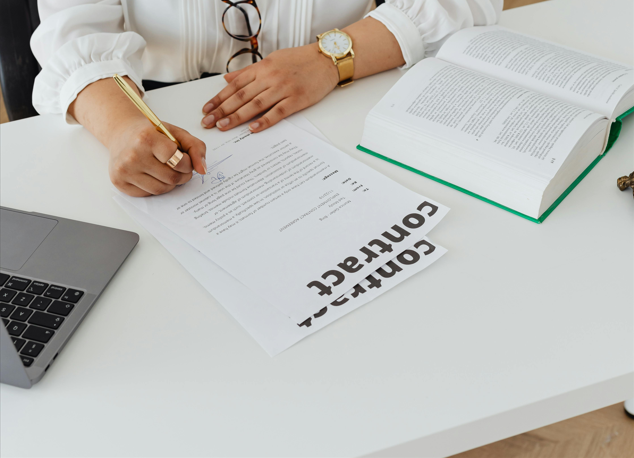
Le déréférencement consiste à faire en sorte qu’un contenu spécifique n’apparaisse plus dans les résultats des moteurs de recherche. Cela ne signifie pas que l’article est supprimé du site où…
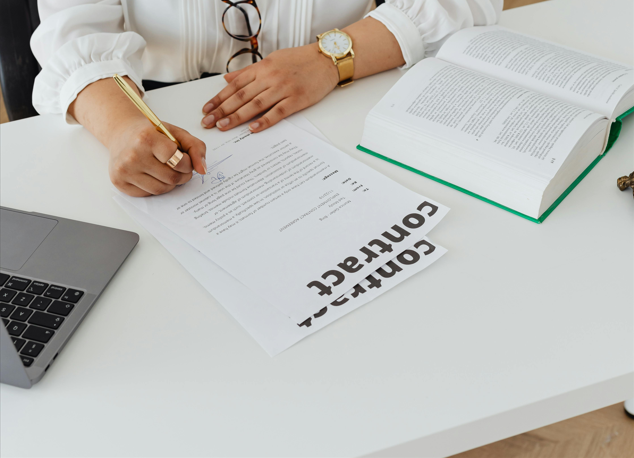
Avec l’expansion rapide du e-commerce au cours des dix dernières années, la concurrence sur Internet a considérablement augmenté. Les comportements abusifs, tels que…
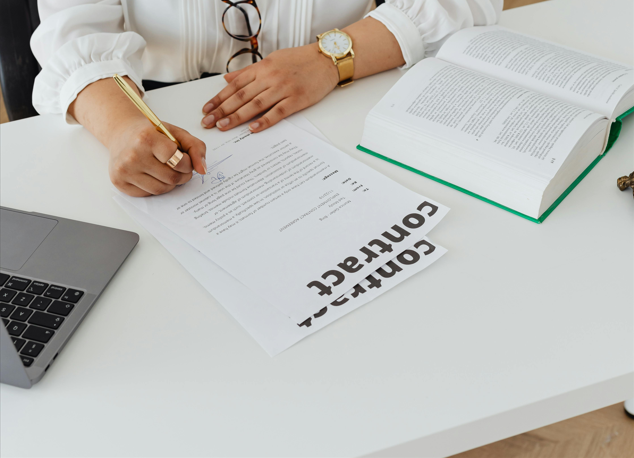
La rupture d’un contrat d’agent commercial est régie par des règles spécifiques, que celle-ci soit initiée par l’agent ou le mandant. Le contrat d’agence commerciale est particulièrement…